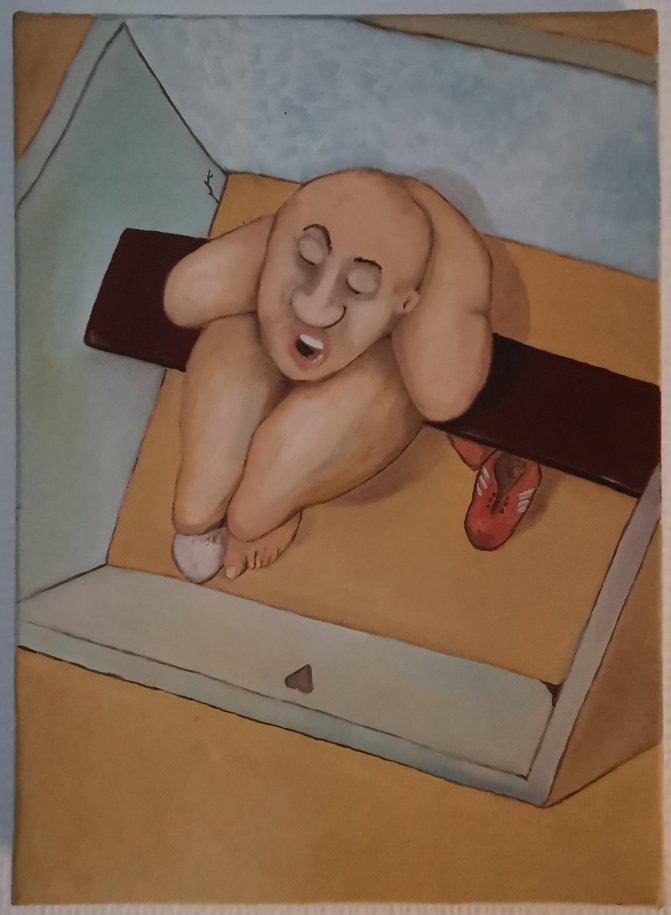Il arrive que nous soyons dimanche et que le soir se faufile doucement par la fenêtre ouverte. Il arrive que nous soyons dimanche et l’envie d’aller voir ailleurs. Il arrive que nous soyons dimanche et la rage envahissante surmonte la décence polissée. Il arrive que nous soyons dimanche et que luttent l’une contre l’autre lassitude et force vive. J’aimerais avoir envie. J’aimerais avoir envie de m’asseoir face à mon écran et d’être tout entière happée par mon travail. J’aimerais être absorbée, centrée, concentrée, habitée d’une force et d’une détermination inusables. Croire qu’il est utile de faire ce pour quoi je suis payée. J’aimerais avoir l’assurance d’être utile, de contribuer à rendre le monde vivable, à le rendre plus juste, plus beau. Je mesure déjà la chance que j’ai, de faire ce travail plutôt qu’un autre qui me plairait moins. D’avoir ce travail tout simplement, et le luxe de m’en plaindre. Je suis ce petit rouage de la machine, celui qui pollue autant qu’il trie, celui qui veut limiter son empreinte et que tord le désir de laisser une trace. Il arrive que nous soyons dimanche et que nos ambivalences nous sautent à la figure. Il arrive que nous soyons dimanche et que la douceur de l’air me rappelle les printemps de mon adolescence qui étaient à coup sûr l’adolescence de ma vie, où je pressentais qu’une liberté immense s’ouvrait à moi. Et comme pour le reste, je me suis précipitée à l’encombrer. Il arrive que nous soyons dimanche, chaque semaine.