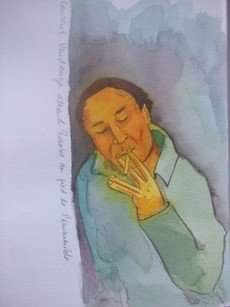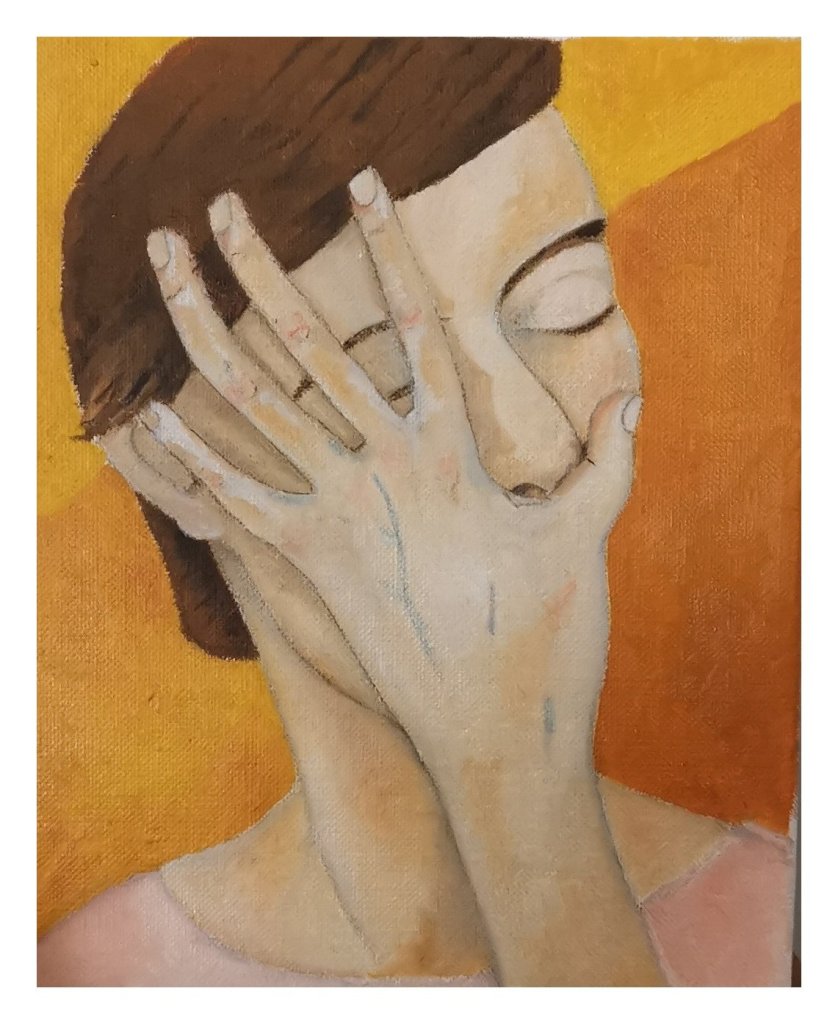J’aime « faire des choses ». Je peins, je cuisine, je pétris, je dessine, j’écris, je cherche des questions, j’ai quatre ou cinq livres en cours de lecture, je lis toutes les publications qui sont à ma portée, un jour j’essaie tous mes vêtements, je range, nettoie, repasse (et j’en passe). Et je m’endors. Parfois je dors trop. L’aboulie trace son sillon, me colle au plancher par KO, je me traîne comme une souche mais je continue d’avancer, mes pensées deviennent lourdes. Je déteste être fatiguée, je m’use dans cet état d’épuisement, comme une corde frottée sur un bord tranchant.
J’aime travailler, aussi. Évidemment. Rester concentrée sur un sujet, gratter tout autour pour le rendre le plus lisible possible, remettre dans le contexte puis l’en extraire et observer. Aller à l’os. Trouver les solutions pour accélérer, supprimer les saisies, ajouter de la couleur (moi, sans couleur, je n’y comprends rien). Voir des pistes d’amélioration partout, essayer tout. Vouloir tout faire. Et puis STOP. Le sens de toute chose se délite. Tout devient vain. Et puis l’état du monde. Et puis les enfants qui souffrent de la bêtise sans fond des adultes. Ascendance, avidité, brutalité…. Petite rengaine qui boucle de génération en génération et apporte sur un plateau son résultat probant : non, ça ne s’arrangera pas.
Je pourrais légitimer mon appétit d’activité par le fait d’avoir subi plusieurs traumatismes, et celui d’avoir le bac pour seul diplôme. Je travaille avec ardeur par peur de tout perdre et de finir sous un pont (puissent vos diplômes vous protéger du chaos…). C’est l’instinct de survie. C’est à lui que je dois peut-être mon odorat ultra développé 😀.
En novembre 2022, j’ai fait un burn-out. Déjà ce mot ne va pas… Littéralement, je me suis « éteinte ». En pratique, je me suis assise, j’ai chialé, pensé moult fois à l’éventualité de me barrer par la fenêtre, j’ai dormi sans parvenir à me réveiller. Je zappais le yoga quotidien. J’ai attrapé dix fois le même rhume. Je me suis cognée à tous les coins de table. Mes avant-bras étaient des enclumes, mon cerveau du Slime gris. Pendant sept mois, ça a été l’enfer total. Mais ça allait. Pas.
Mon médecin a posé le diagnostic du burn-out puis de la dépression. Il m’a confiée au trio gagnant : psychiatre, psychologue, molécule.
Au bout de sept mois, j’ai repris le travail, balayé devant ma porte, fait la part des choses. Il m’arrivait encore de m’écrouler. Me relever. Ça allait. Pas. Le Slime gris revenait au galop (visualisez cette image, histoire de rire un peu), puis se transformait en petit nuage rigolard tout mignon. Euphorie chérie.
La molécule avait visiblement ses limites (les miennes). Changement de diagnostic : je serais atteinte de troubles bipolaires. Je l’écris au conditionnel, car il me semble que la partie n’est pas encore gagnée. Ce que je décris là, c’est l’importance de nommer (car « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde. » Camus avait raison).
Mon objet d’étude est cet état qui porte plusieurs noms. Des états proches. Des voisins qui se font la guerre. Les nommer permet d’avancer vers la compréhension de soi et de ma façon de réagir à mon entourage (contexte mouvant). Dans mes phases basses, je me prends des réflexions anodines en pleine figure, tout signal faible devient une alerte tonitruante. Je décortique les phrases et leur prête un sens parfois absurde. Apprendre à identifier cet état et le nommer permet de l’apprivoiser. Plutôt que m’écrouler en pleurs, je vais me dire « tu penses trop loin, va marcher ».
Les phases hautes, c’est le bonheur. Je voudrais que toutes mes journées soient en phase haute. J’imagine que c’est le cas de tout le monde.
Je ressens une grosse gratitude pour cette petite pilule que j’avale chaque matin à heure fixe. Je suis pourtant de celles qui ne prennent pas d’antalgique (car on ne soigne pas la maladie en traitant le symptôme). Toutes mes certitudes ont vacillé, je deviens sociable (c’est dire). J’habite mon corps alors qu’avant je flottais à côté.
La santé mentale est le dossier du moment. Dans la continuité du mouvement #metoo, les mots dépassent le tabou, cette grâce à taire qui a tant séduit. Le lien entre les deux n’est d’ailleurs pas qu’une affaire de libération de la parole. Les deux sont les fruits de nos systèmes, de nos modes de vie : ascendance, avidité, cruauté (voir plus haut). Le milieu professionnel m’apparaît comme le meilleur endroit pour comprendre les fissures, tant les interactions y sont nombreuses. Tant il est un système dans le système. Il peut aussi devenir une source d’aide.
Avoir identifié des personnes ressource m’aide autant que le trio gagnant psychologue, psychiatre, molécule. Lorsque je commence à me décaler, je vais visiter mon voisin du dessus et je lui dis que je travaille trop. Si j’ai un besoin irrépressible de rire, ou questionner un sujet annexe, j’appelle ma correspondante d’en face et nous buvons un thé.
Il y avait beaucoup d’isolement dans ma vie au travail, parce que je ne faisais QUE travailler (et j’aime ça). Il y a bien un « out » dans ce burn-out, j’ai fini par sortir cette maladie pour la regarder de près et la comprendre. La rendre utile aux autres, c’est observer mon entourage avec ma part blessée et écouter la façon dont elle entre en résonance avec l’autre. Il ne reste plus qu’à trouver des astuces, des recettes, identifier des pistes pour freiner le mal-être au travail. J’ai quelques pistes…